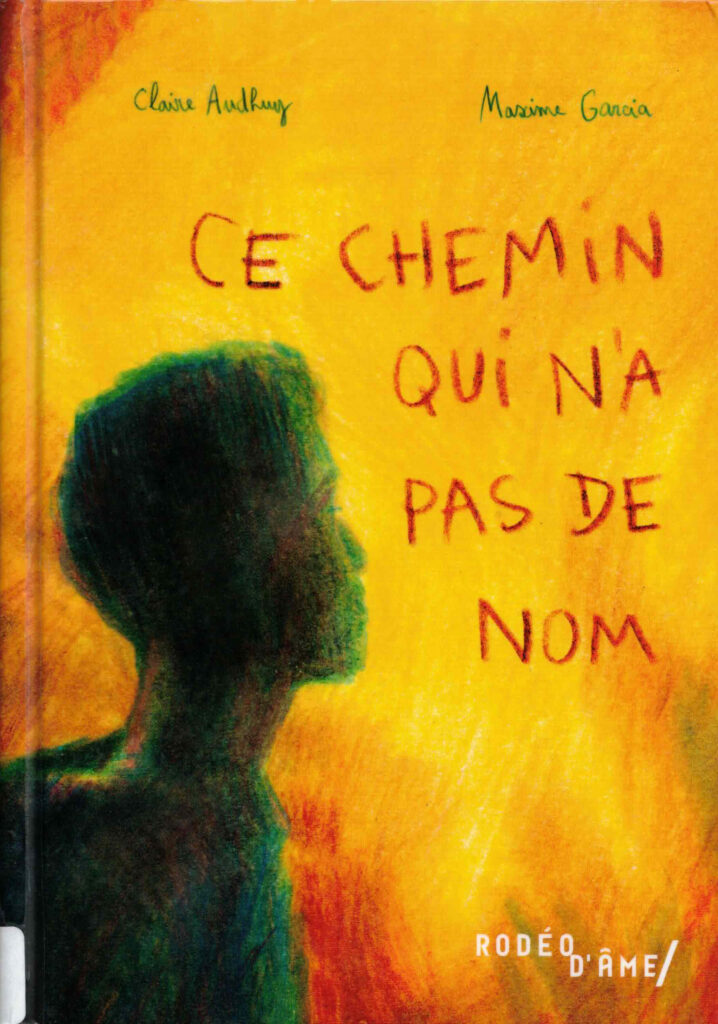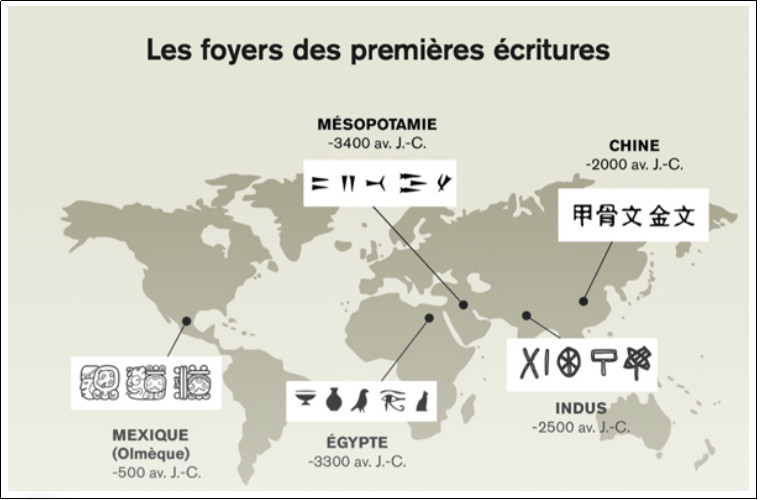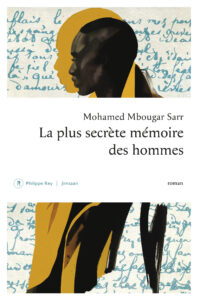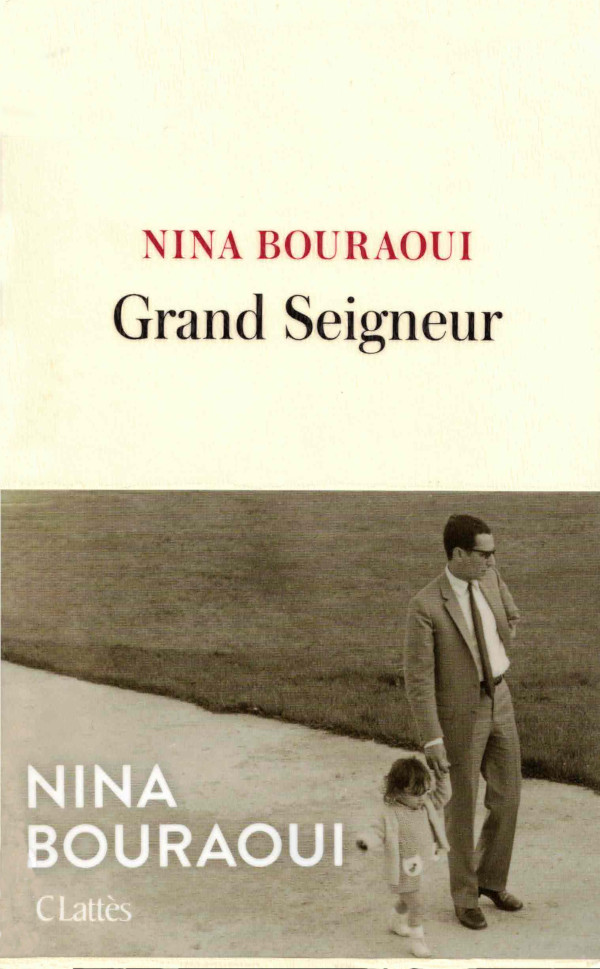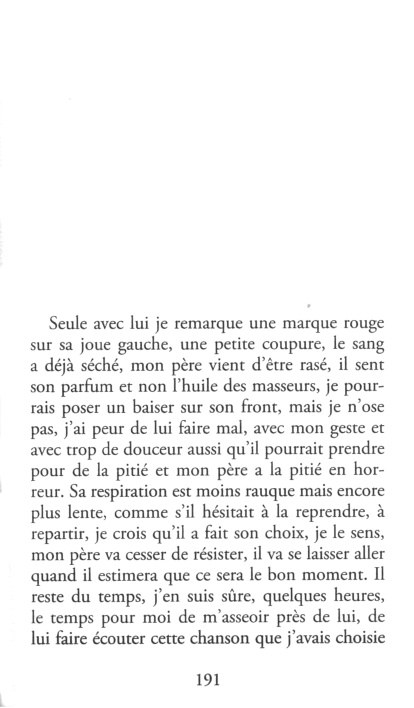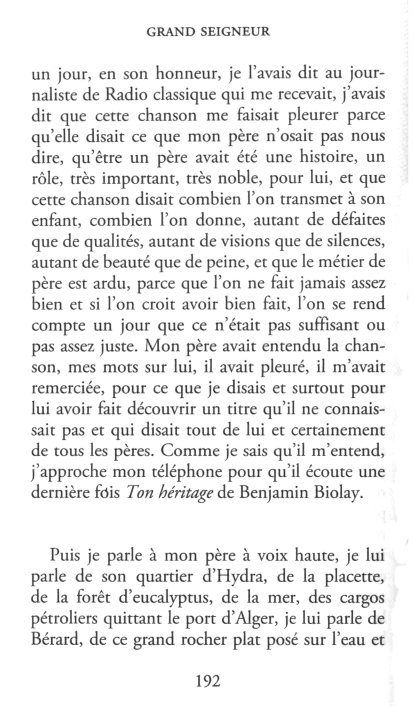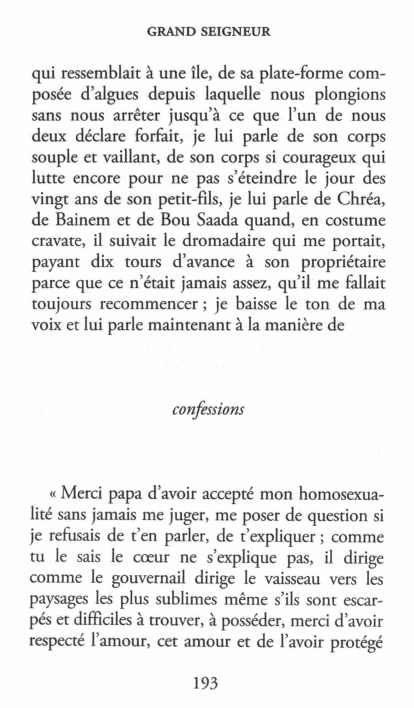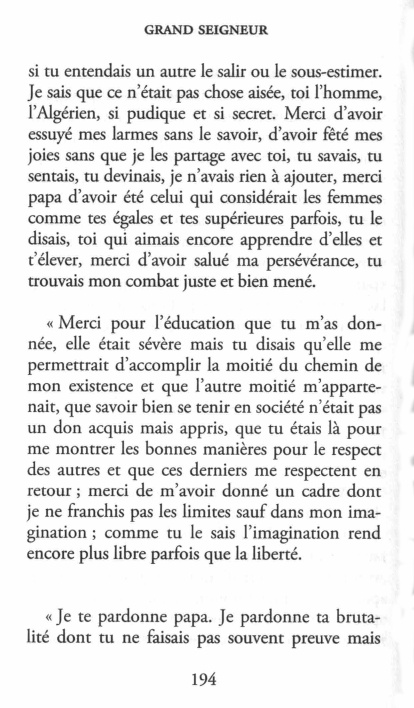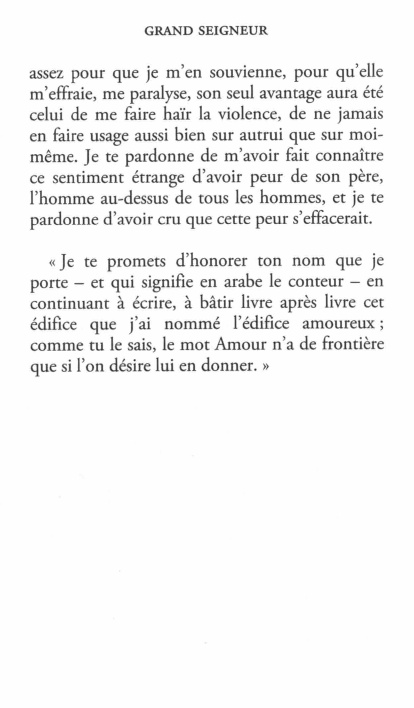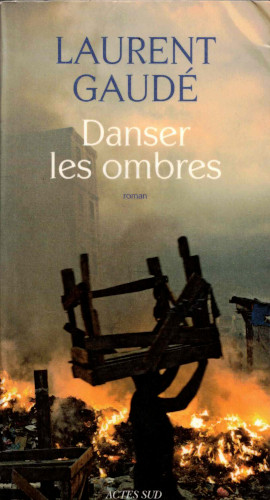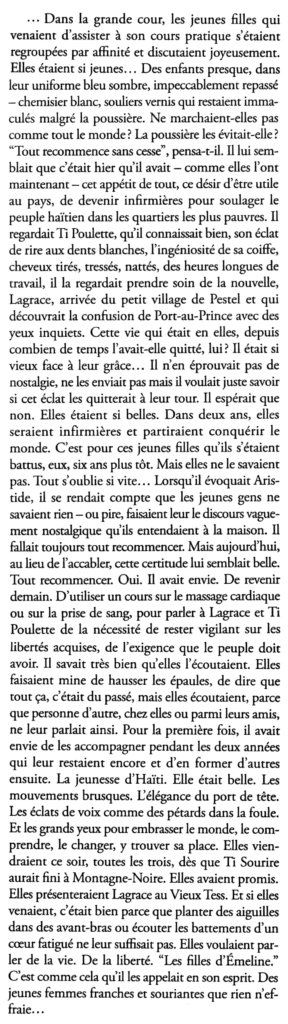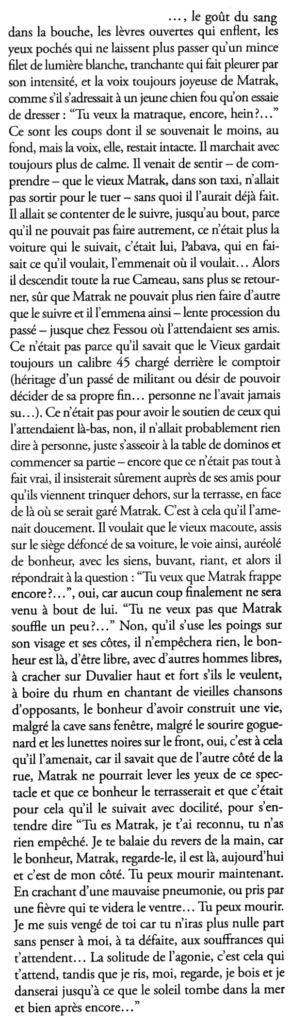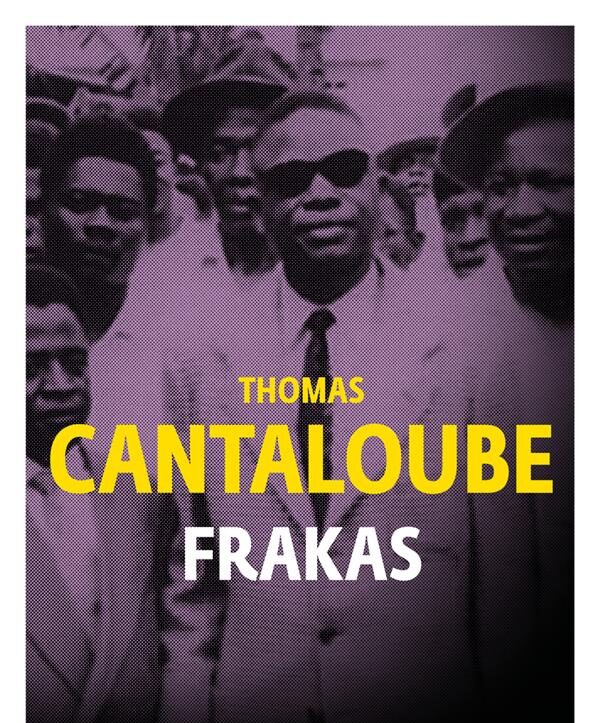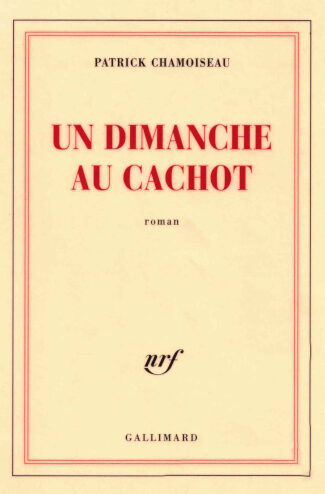

Ce livre est un roman. Enfin… c’est écrit dessus, mais en est-ce vraiment un ? ou alors, c’est un roman bien étrange, entre histoire, culture créole et philosophie.
C’est l’histoire d’une petite fille à moitié folle, Caroline, enlevée à des parents drogués et brutaux puis confiée à une institution, la Sainte Famille.
Les bâtiments de cette institution sont construits sur l’emplacement d’une très ancienne plantation sucrière esclavagiste dont ne subsiste plus aujourd’hui que quelques vestiges en ruines. Et un peu à l’écart, une voûte sombre faite en pierres et à moitié enterrée est restée de cette époque.
Caroline ne s’est pas intégrée avec les autres enfants de l’institution, elle reste très isolée et, de façon inexplicable, fuit souvent se réfugier sous cette voûte en ruine où elle parait se sentir mieux, se détendre et s’apaiser. Sylvain, un éducateur de l’institution, a pourtant tout tenté. punitions, récompenses, pour sortir Caroline de son isolement, mais en vain.
Alors, en désespoir de cause, il demande à un ami, l’auteur, lui donc l’écrivain mais aussi éducateur de métier, de rejoindre Caroline sous cette voûte refuge pour tenter d’établir une relation avec elle, pour parler avec elle et pour essayer de la faire revenir.
C’était un dimanche pluvieux, un peu vide et désœuvré que tous les deux, Caroline et l’auteur, vont se retrouver comme piégés, enfermés pour de très longues heures sous cette voûte qui semble se refermer sur eux.
C’est le début de la plongée de l’auteur dans l’histoire de cette voûte sinistre où Caroline l’a attiré. Et il va y rencontrer tous les personnages du passé esclavagiste de cet endroit.
Il y a le Vieux Blanc aujourd’hui disparu, le défricheur, le violeur l’Oubliée et de la mère de l’Oubliée et de tant d’autres.
Il y a L’Oubliée, fille du Vieux Blanc et rejetée par sa Manman Bizarre, l’Africaine, Mais voici aussi La Belle, mystérieuse, indomptable, maléfique avec son ongle menaçant et qui s’avérera être la grand mère de L’Oubliée et la mère de l’Africaine. La mère et la grand mère se précipiteront vers la mort et les tortures plutôt que de subir l’asservissement.
Et il y a le Maître-Béké, le fils du Vieux Blanc, qui a repris la sucrerie esclavagiste lorsque le vieux blanc est devenu trop vieux puis est mort. Le Maître-Béké et son molosse dominent par le terreur ce lieu peuplés d’esclaves noirs déportés depuis l’Afrique.
Il y a le Vieil Esclave et Sechou tous deux seuls compétents pour la cuisson des cannes à sucre et donc à la fois indispensables au Maître et aussi inexistants comme êtres humains aux yeux du Maître, parce que noirs et esclaves, juste des machines. Le Vieil Homme puis Sechou vont marronner et fuir la sucrerie et le Maître-Béké et son Molosse sans que ces derniers ne parviennent à les reprendre pour les châtier.
Et il y a le Visiteur, le vendeur de porcelaine, qui est venu de France jusqu’ici, Hostile à l’esclavage il est venu pour constater, pour comprendre et pour témoigner. Son nom ? Victor Schoelcher.
L’Oubliée a eu peur pour le Vieil Homme lorsqu’il s’est enfui et
Parce que dans la déraison de ces mots étranges incompréhensibles résonnent les profondeurs de la lointaine et originelle Afrique, le Maître-Béké fait jeter au cachot L’Oubliée.« elle avait maudit le ciel avec les mots de sa Manman Bizarre: consonnes vélaires, gutturales, qui s’épenchaient comme une grouillée de bêtes. »
Le cachot, c’est un lieu d’horreur dont on ne sort pas vivant, c’est en soit une torture;
« ce machin-là, c’est la mort en figure… c’est la mort dans la mort… »
en dit Sechou au visiteur.
Cette voûte sombre où Caroline et l’auteur se retrouvent enfermés est peut-être bien le vestige du cachot où L’Oubliée a été enfermée. Et l’auteur en écrivant pour son roman l’histoire de L’Oubliée, revit avec Caroline toute l’histoire dont elle-même est issue, son histoire.
Dans le cachot, L’Oubliée doit affronter le vide, la promiscuité effrayante des rats, des vers et des insectes rampants piquants mordants, et puis aussi la menace mortelle et de plus en plus proche et précise des bêtes-longues agressives et venimeuses. Comme sa mère l’Africaine et sa grand-mère La Belle, L’Oubliée ne cède pas à la peur de la mort. Mais elle échappe à la mort, elle affronte son destin et finit par réussir à survivre au cachot et aux bêtes-longues. L’Oubliée finalement quittera le cachot et la plantation sucrière sans avoir besoin de fuir, en passant calme, tranquille, la tête droite devant le Maître et son Molosse qui s’écarteront et la laisseront aller et partir vers les grands bois pour rejoindre ceux déjà partis.
Et Caroline accompagne l’auteur lorsqu’il s’enfonce profondément dans l’histoire de L’Oubliée, elle le soutient lorsqu’il vacille et risque de se perdre dans les ténèbres de la voûte et de l’histoire terrible qu’il écrit. C’est Caroline qui finalement sort la première de la voûte et tend la main à l’auteur pour l’aider à sortir à son tour quand Sylvain est venu les chercher. Et Sylvain est éberlué de voir que Caroline est devenue docile, qu’elle ait retrouvé un regard d’enfant et qu’elle soit allée spontanément rejoindre les autres enfants.
Sylvain dit que c’est grâce à l’auteur que Caroline est sauvée de son isolement et sa folie, mais non, l’auteur ne le pense pas.
Lui pense simplement ceci:
« J’avais seulement incarné dans ce cachot la douloureuse liberté que L’Oubliée était forcée de s’inventer. Sechou, le Maître, L’Oubliée, le visiteur… je les avais laissés me traverser en plusieurs mailles… Je les avais regardés vivre leur vie en moi, sans moi. Aller vivre leurs libertés en moi sans rien leur demander d’autre qu’une petite distance, ma propre liberté… »
« C’est en restant indécidable qu’une liberté peut ouvrir à toutes les libertés »
C’est un beau texte !« La beauté est toujours neuve, c’est son signe. Elle se renouvelle et renouvelle toujours et c’est pourquoi on ne saurait la définir. Elle ne peut entraîner ni tyrannie ni barbarie quand on la cherche toujours et qu’on n’arrête pas. De la chercher toujours vous confie à la grâce ,.. cette grâce partout comme une légèreté. Ce que confère la grâce c’est l’intuition de la beauté. »